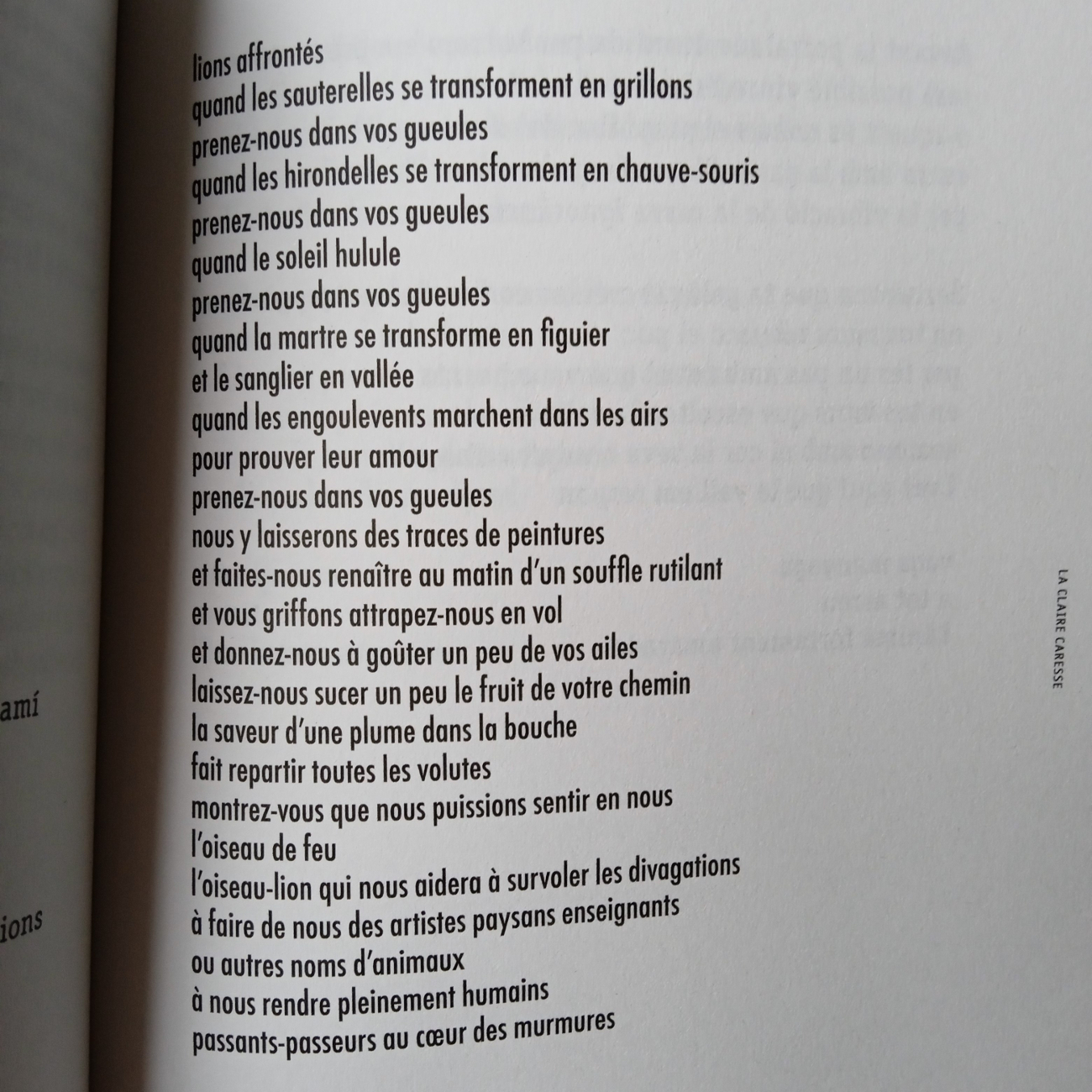Hier notre groupe a traversé une zone de turbulences. L’urgence dans laquelle nous travaillons, l’imminence de nos restitutions et la fatigue accumulée ont vu des larmes couler (pas les miennes mais il s’en est fallu de peu), le ton monter, des menaces de retrait proférées mais finalement il semble que nous ayons réussi à préserver notre unité. Par chance, les poètes reformulent volontiers.
Les échanges étaient vifs comme le cours de l’Eure.

Ci-dessous, une vue de la Factorie, de dos ; la salle dans laquelle Anna, Emanuel et moi aimons travailler est au premier étage ; la fenêtre du milieu est la meilleure place.

J’ai fini ce matin le texte que je vais lire jeudi soir lors de la restitution publique des travaux menés pendant la résidence. Avant que la Factorie ne s’anime, au lever du jour, j’ai répété depuis la meilleure place de la grande salle qui surplombe la rivière avec pour seul public le martin-pêcheur qui semble vivre toujours sur la même branche.

Hier soir, Emanuel et moi y avons travaillé, chacun face à sa baie vitrée, séparés par un rideau de théâtre bleu nuit. La lune presque pleine était si belle vue à travers les vitres gondolées, derrière les arbres chargés de gui, que j’ai pris les photos ci-dessous. Entendant le déclic de mon appareil, Emanuel a dit « Toi aussi, tu regardes cette magnifique pleine lune ? » Tant de beauté nous déconcentrait. Vérification faite, c’est pour cette nuit : la pleine lune du loup. Mais nous ne la verrons pas, nous serons à Rouen pour écouter la lecture de notre amie Catherine au foyer des marins.