J’ai décidé de tenir un journal de confinement. Il commence un jour avant JC (Jour de Confinement) ; qui sait quand et pourquoi il s’arrêtera. J’aurais pu l’appeler Journal Crépusculaire, ce serait JC aussi.

JC – 1
Plusieurs heures avant l’allocution présidentielle, je réussis à convaincre mon amour de quitter la capitale pour se réfugier chez moi avec ses enfants. Pendant qu’elle charge sa voiture, je procède à un ravitaillement piéton (ça consiste à faire des allers-retours éprouvants car je n’ai pas de petit caddie – vivent les caddies, je m’en procure un dès que les magasins de caddies rouvrent leurs portes, si je suis toujours de ce monde).
Dans les supermarchés, il n’y a personne, je n’attends pas à la caisse. J’ai lu dans la presse que l’on assistait partout à des scènes d’anticipation mais, à ma perplexité, Lens est aussi calme que d’habitude. Les rares clients que je croise dans les rayons bien achalandés sont exaspérés ou méprisants parce que je porte un masque : je comprends qu’en étant prudente, je leur fais peur. Seule une dame me demande où je l’ai eu, pleine d’espoir, et je dois m’excuser. C’est un ami de mes parents qui me l’a fait parvenir quand tout le monde se payait ma tête parce que j’avais peur, il y a plus d’un mois. Je lui dis que je suis désolée, elle hausse les épaules : On ne sait jamais, dit-elle.
S’il y a des SDF à Lens, je ne les ai jamais vus. En revanche, il y a plusieurs groupes de clochards, des anarchistes qui boivent des cannettes en refaisant le monde. Que va-t-il advenir d’eux ? Où seront-ils confinés, dans quelles conditions ?
JC
Je cours au 11/19, embrasse la vue de là-haut, l’embrasse aussi fort que possible dans mon esprit au cas où je la verrais pour la dernière fois. Au retour, je passe devant un supermarché ; hier, il était désert, aujourd’hui les gens s’agglutinent le long du bâtiment, sans masque. Que faisaient-ils hier ? J’ai beaucoup d’empathie pour ceux que leur scepticisme met en danger.

Lens est une ville surréaliste. C’est l’une de ces communes où l’association des commerçants a obtenu l’autorisation de diffuser de la musique dans les rues du centre-ville ; en l’occurrence, Chérie FM – radio censée magnétiser les foules et dynamiser la consommation. Aujourd’hui, les foules ne sont toujours pas de la fête mais elles ne sont plus souhaitées, pourtant nous vivons l’expérience d’elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux les pigeons dans une ville fantôme.
Je descends de voiture devant la gare, l’amie qui se réfugie chez moi a perdu une roulette de sa valise avant de monter dans le train à Lille et nous ne pouvons acheminer à pied jusque chez moi les 93 kilos de livres qui sont venus à bout de ladite roulette (c’est une amie étudiante). Je traverse le parvis désert sous le soleil printanier, dans le hall il y a un couple, sur les quais il n’y a personne. Curieusement, c’est l’image de TER assoupis qui me serre le cœur. Je veux voir des trains circuler, des gens monter et descendre sur des quais perdus au milieu de presque rien, sans même un guichet automatique, des inconnus affairés à des vies que je ne connais pas. Je promets à ces TER que nous vivrons encore plein de belles choses, eux et moi, Mon Bolide pendu par la roue avant dans leurs secousses.
Le train de mon amie arrive en même temps que moi sur la voie B. Il est 11h50, sans doute est-ce le dernier train avant nouvel ordre, je m’attends à ce que des hordes effarées en descendent mais non, mon amie n’a dû partager les wagons qu’avec trois autres passagers.
Nous sommes cinq dans ma maison, que je ne pourrai plus jamais appeler mon Vaisseau Fantôme. Je l’appellerai désormais Socorro, comme la maison où se réfugient mes personnages dans L’éternité n’est pas si longue. Le déjeuner au soleil dans le jardin est si joyeux que nous oublions un instant ce qui nous réunit ici.
Le soir, les jeunes ont peur de sortir : peur d’être arrêtés et emprisonnés – bien que j’aie imprimé leurs attestations. Mon amour et moi marchons dans le coucher de soleil au bord du canal ; il n’y a personne nulle part, quelle surprise : même en temps de paix, il n’y a personne par ici, hors oiseaux d’eau. Sur les routes, des bus vides, bulles de lumière flottant silencieusement sur les rubans de bitume.

JC + 1
J’ai mon attestation d’activité physique. Depuis le sommet de mon terril préféré (ni le plus beau ni le plus haut, juste mon terril de cœur), j’entends une chanson des années 60, un truc de crooner, porté jusqu’à moi depuis un point indéfini que je situerais de l’autre côté du canal ; par moments, plusieurs voix très jeunes entonnent les paroles en chœur ; sous mes yeux, un chemin de halage désert, un stade désert et, au-delà, des rues désertes. Sur l’autoroute, pas de bouchon mais quelques camions isolés.

(Avant JC : autoroute très fréquentée.)

(Après JC.)
Sur les terrils, les lapins bondissent de nouveau, libérés de la menace des chasseurs et justement indifférents à notre sort ; les canards s’aventurent hors des cours et plans d’eau ; les oiseaux donnent un récital.

De retour au sol, je lance ma playlist dancing chicken (il y a Carter Tutti Void, Anna Meredith, Fátima Miranda, etc.), je danse au bord de l’eau, je danse pour l’humanité parce que tel est mon sens de l’absurde, un instant je peux faire tenir tout le sens d’être en vie dans cette gesticulation inutile et désordonnée, ça me rend heureuse – je n’ai pas honte d’être heureuse en cet épisode sinistre, c’est à la fois un travail et sa récompense, et après tout il s’agit seulement d’un instant.

Dans sa pâture, Danny paresse au soleil.


Comme dans L’éternité n’est pas si longue, mes compagnons de confinement et moi sommes répartis dans l’espace de la maison, sauf aux heures de travail, où la plupart se réunissent dans le salon. Une collégienne, un lycéen, une étudiante, une salariée en télétravail et moi, chacun sur son ordinateur, entouré de ses carnets et de ses livres.
La grande différence avec mon roman, c’est que nous n’avons pas la télévision et ne commentons pas sans fin ce qui se passe dehors. Mon amour et moi en parlons autant que possible en retrait, évitant désormais que des oreilles ne traînent quand je dis que bientôt, il y aura une pénurie et des pillages.
Après des jours d’angoisse où je m’efforçais, avec des succès variés, de faire comprendre et admettre l’urgence de la situation à mes proches et d’organiser notre mise en sécurité (j’ai notamment contribué à la décision de ma meilleure amie, de ne pas aller travailler dimanche dans un bureau de vote, soit un geste courageux de résistance à la décision criminelle de maintenir les élections, et convaincu mon amour de ne pas jouer les capitaines du Titanic sur son lieu de travail), après ces longues discussions tendues, je m’aperçois que j’ai soudain perdu de vue la raison de tout ceci, oublié le virus pour me concentrer sur l’aventure du confinement. Aujourd’hui, ça me semble la meilleure chose à faire : nous focaliser sur l’organisation de nos journées, sur nos interactions, sur nos activités, pour ne pas sombrer dans la terreur. Dans quelques jours, quand les chiffres seront devenus vertigineux, les plus goguenards et les plus insouciants cesseront de nous mettre en danger ou de penser que leurs problématiques d’avant ont encore cours. Il ne restera plus qu’à attendre. Il faudra nous employer à emplir cette attente, en dehors de laquelle tout le reste nous apparaîtra crûment pour ce qu’il est : dérisoire et hors sujet.
Je suis infiniment reconnaissante aux quatre personnes qui m’entourent d’avoir cru à mes prédictions et d’être là, avec moi. Pourtant, je sais que même si nous nous en tirons, nous allons tous perdre des êtres chers. Il est mathématiquement impossible d’y échapper. Quant à Dame Sam, elle aime avoir cinq personnes à son service plutôt qu’une seule mais n’apprécie pas trop qu’on encombre son espace ; en substance, elle ne sait que penser de tout ça et vocifère jusqu’à l’épuisement.
Une voisine me dit que tout ça, c’est à cause des Chinois qui bouffent de la merde. Certains pensent que nous (première erreur : quel nous ?) allons beaucoup apprendre de cette expérience et en tirer des leçons, mais comme je l’écrivais déjà il y a dix ans (quand j’imaginais exactement ce qui est en train de se passer), les humains n’apprennent pas de leurs erreurs. Par ailleurs, je suis sûre que certains ont 99 paquets de pâtes dans leur garage et se moquent de savoir comment vont leurs voisins.
Nous allons marcher, scindés en deux groupes sur des routes désertes. Un TER vide file sur le pont ferroviaire qui chevauche le canal. J’ai arrêté de compter les bus vides, je me contente de regarder les chauffeurs, des hommes et des femmes ; ils nous regardent aussi. L’un d’eux a passé le bras par la vitre baissée, on dirait que son regard essaie de me dire quelque chose.
Nous nous réunissons au pied d’un terril désert, le gravissons. Les jeunes découvrent la vue de là-haut. Nous les regardons courir et prendre des photos, nous les regardons regarder.

C’est un moment de consolation, dans la lumière de fin d’après-midi. Je danse devant un amphithéâtre en plein air face à un étang, pour mon public de quatre humains, qui applaudissent chaleureusement (sans bisser pour autant), et de nombreux oiseaux d’eau.

Nous repartons en deux groupes. Premier contrôle de police : un agent sans gants ni masque prend nos attestations et nos cartes d’identités, nous les rend. Nous nous demandons combien de sujets contaminés ont été contrôlés avant nous par les mêmes mains non désinfectées en l’absence de gel hydroalcoolique.
 Je dis, Demain soir, chacun fera écouter trois musiques aux autres et leur en parlera ; tout le monde y voit une perspective joyeuse. Puis je regarde les derniers chiffres et j’ai envie de vomir.
Je dis, Demain soir, chacun fera écouter trois musiques aux autres et leur en parlera ; tout le monde y voit une perspective joyeuse. Puis je regarde les derniers chiffres et j’ai envie de vomir.


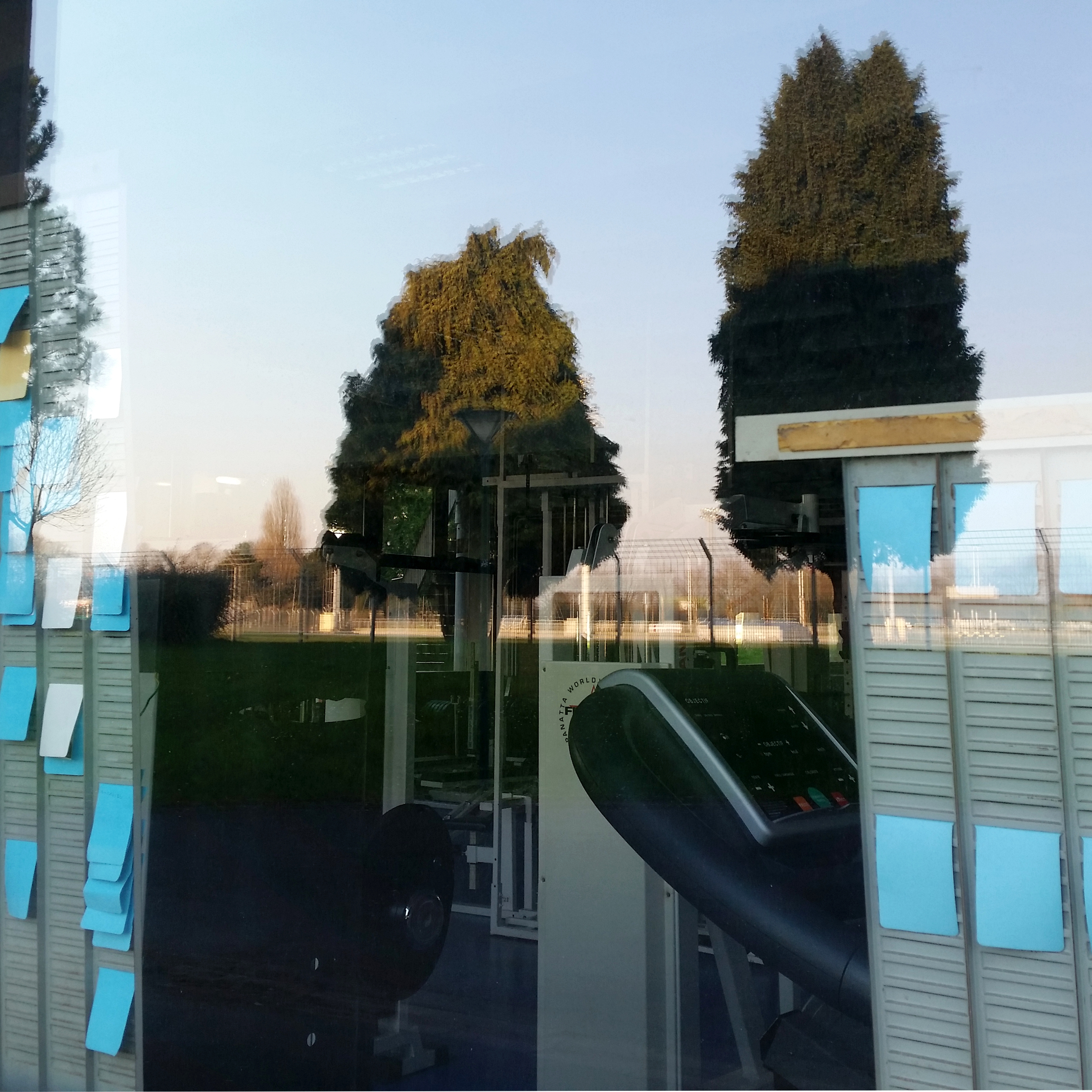







































































 Je dis, Demain soir, chacun fera écouter trois musiques aux autres et leur en parlera ; tout le monde y voit une perspective joyeuse. Puis je regarde les derniers chiffres et j’ai envie de vomir.
Je dis, Demain soir, chacun fera écouter trois musiques aux autres et leur en parlera ; tout le monde y voit une perspective joyeuse. Puis je regarde les derniers chiffres et j’ai envie de vomir.