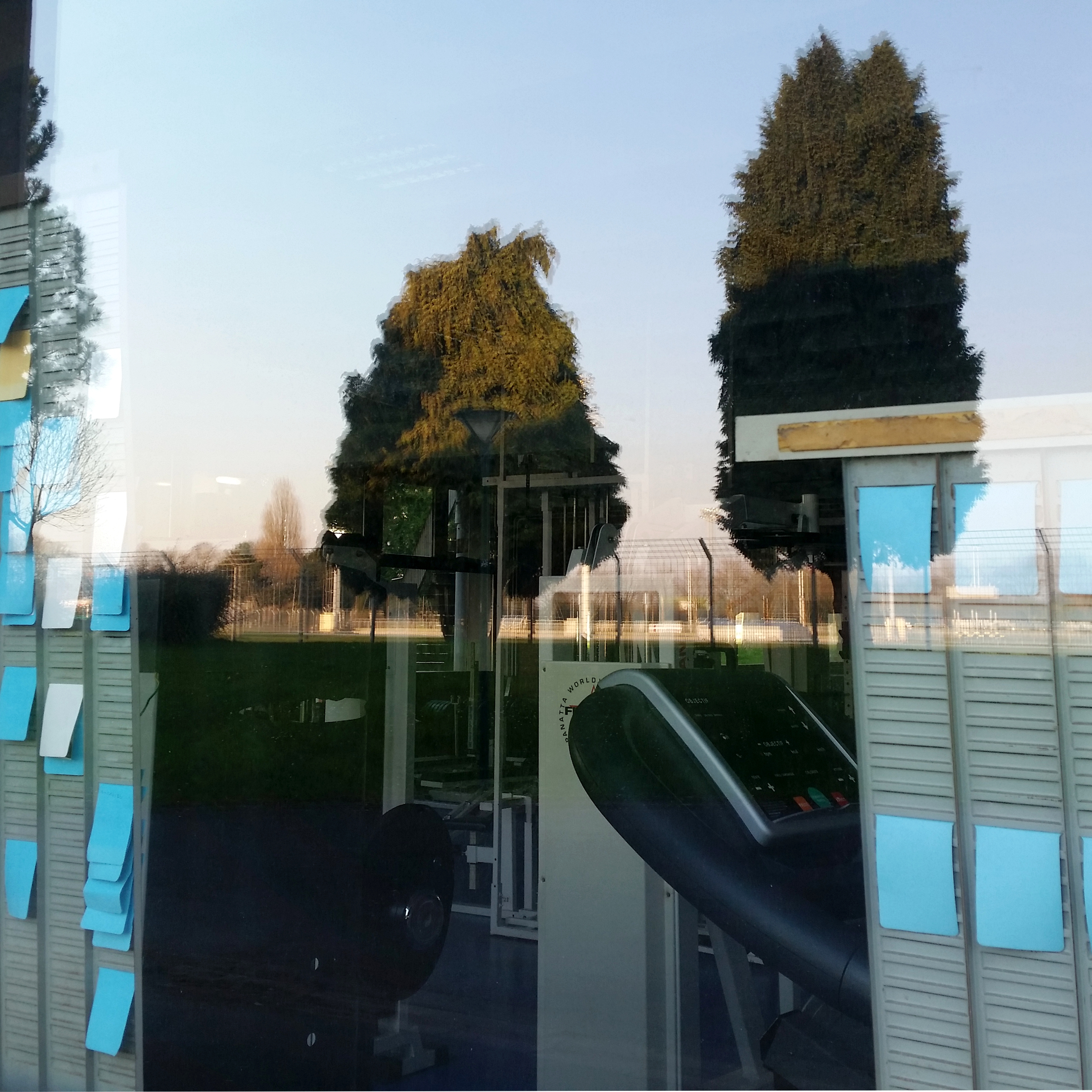J’évoquais dans A happy woman l’album que Meredith Monk préparait avec Bang On A Can quand je l’ai rencontrée, en 2017 ; il est sorti avant-hier et s’appelle Memory Game. Il est très différent des roughs que, grâce à mon amie Allison Sniffin, j’ai déjà écoutés mille fois : c’est presque un autre album, en vérité. Je vais pouvoir l’écouter mille fois, à son tour. J’avais de longue date décidé que pour mon enterrement je voulais l’une de ses pistes, Tokyo Cha Cha, un petit bijou quasi pop. Nous devons ses arrangements à la même Allison (qui, entre parenthèse, met à profit son confinement dans le New Jersey pour composer une super pièce aux intonations presque jazz, par instants – c’est du moins mon humble avis). Ce matin, alors que nous prenons le petit-déjeuner, chacun à une table différente (je ne suis apparemment pas la seule ici dont la sociabilité ne vaille pas grand chose avant le premier thé), je passe Tokyo Cha Cha, au grand plaisir de mes co-confinés. Mon amour trouve que c’est une belle manière de commencer la journée.
En ville, aujourd’hui, un vide jusqu’alors inégalé. En comparaison, le 15 août est une foule, un grand rush, et hier était un samedi après-midi. Le grand ballet des sacs plastique se poursuit, chaque jour plus ambitieux, de plus volumineux danseurs rejoignant en plus grand nombre sa spirale infinie dans la tempête.

D’automobile, aucune. Atmo HDF me signale la fin du pic de pollution. Le vent a fait un super boulot ; il peut se reposer, maintenant.


Il a aussi disséminé les gants : peut-être demain des gens se prendront-ils dans la figure un gant qu’ils ont lâché par terre hier en sortant de la supérette et qu’ils en convulseront d’horreur alors que c’est leur ADN dessus, leurs fluides corporels, leur coronavirus ! Ce serait drôle, ça, comme s’ils faisaient pipi contre le vent.

La nature existe encore, quelle consolation… Et, mieux encore, elle se repose de nous et de nos œuvres.

Il faudrait beaucoup de temps pour qu’elle recouvre toute sa pureté, même si nous ne revenions jamais l’empoisonner. Les décharges sauvages dans les bois et les clairières nous laissent perplexes, cet après-midi, mon amour et moi, non qu’elles nous surprennent encore mais l’énormité de la bêtise qu’elles dénotent est incommensurable et notre effroi est à sa mesure ; elles me répugnent et me dépriment tant que je ne peux me résoudre à les prendre en photo ; à la limite, je peux en montrer une trace qui a été soumise au feu, en quelque sorte lavée – une ordure comparativement propre :

Sans nous, la nature resplendit avec une délicatesse nabi,

elle miroite et chante et chuinte.

Nous y trouvons trois météorites semblables à celle-ci, des blocs ontologiques tombés du ciel,

et du sol aussi jaillissent des motifs plus fascinants et admirables qu’aucun schéma de main humaine.

Ces derniers jours, j’ai souvent fantasmé d’aller vivre dans les bois. Quand ma raison a flanché, avant-hier, j’ai cru que mon amour allait me fuir pour toujours et je me suis dit que si je devais être confrontée à un tel cauchemar, j’abandonnerais tout et partirais dans les bois avec un sac à dos, un peu de matériel de camping, et irais m’achever au milieu des petits mammifères et des oiseaux. Je m’accrochais à cette image, la seule qui me consolait tandis que je tremblais de peur. Je me demandais seulement si Dame Sam accepterait de m’accompagner – c’est une vieille Dame, elle aime son confort et sa tranquillité. Je savais déjà exactement où j’irais, comment, et ce que j’emporterais dans mon sac à dos. Puis je me suis rappelé un film et un livre que par coïncidence j’ai découverts successivement, il y a deux ou trois mois, et dans lesquels des résistants à un système oppressif se réunissent dans les forêts : Lobster de Yórgos Lánthimos et Notre vie dans les forêts de Marie Darrieussecq. Ce n’est pas un hasard, cet élan qui nous pousse vers les bois. Il y a deux races, me dis-je : il y a ceux qui continueront de s’agglutiner dans les villes dont la densité de population fait des bombes atomiques à retardement, et il y a ceux qui fuiront dans les forêts. Je rumine cette idée depuis plusieurs jours et voici que nous découvrons, au cours de notre promenade du jour, un campement détruit dans un bois bien caché.

Deuxième fin de journée au fenouil. Et, notre lycéen ayant trop de travail, pas plus belote que d’apéro ce soir. C’est pourquoi je peux poster ce JC+12 à JC+12. Une première dans ce Journal de Confinement.